
Saint-Germain-des-Prés évoque immédiatement les caves enfumées, les discussions existentialistes et la silhouette de Boris Vian, trompette à la main, incarnant l’esprit rebelle de l’après-guerre. Pourtant, cette image d’Épinal masque une réalité plus complexe et stratifiée.
Suivre les traces de Vian dans ce quartier ne consiste pas à cocher une liste de cafés mythiques, mais à déchiffrer les strates invisibles d’un territoire que l’artiste a habité, transformé, puis critiqué. De la géographie physique des lieux qu’il fréquentait réellement aux résonances contemporaines de sa présence, en passant par les mémoires sonores du quartier, ce parcours révèle une relation paradoxale entre l’icône et son mythe.
Car Vian lui-même a participé à la construction de Saint-Germain avant de s’en détacher, conscient de la muséification touristique qui transformait l’authenticité en folklore. Explorer ses traces aujourd’hui impose donc une lucidité : celle de comprendre que l’artiste fuyait précisément ce que nous cherchons.
Saint-Germain par les yeux de Vian : l’essentiel
- Les véritables adresses de Vian dépassent le mythe : Cité Véron à Pigalle, Office du Jazz, appartements successifs
- Trois périodes distinctes révèlent trois identités : le jazzman clandestin, l’écrivain-célébrité, l’artiste désenchanté
- La dimension sonore du quartier offre une cartographie alternative centrée sur les caves de jazz et l’acoustique urbaine
- Vian a critiqué la commercialisation de Saint-Germain dès 1950, créant une ironie pour tout parcours contemporain
- Composer un itinéraire personnalisé selon ses affinités permet une relation authentique avec l’héritage vianien
Les vestiges architecturaux que Vian a réellement habités
Contrairement aux parcours touristiques qui privilégient les cafés légendaires, les espaces domestiques et professionnels de Vian révèlent une topographie plus intime et contradictoire. Ces lieux subsistants permettent de distinguer la réalité matérielle du mythe construit a posteriori.
La Cité Véron, impasse discrète du 18ᵉ arrondissement nichée derrière le Moulin Rouge, accueillit Vian de 1953 jusqu’à sa mort en 1959. Cet appartement, où l’appartement de poche de Boris Vian ne mesurait que 30 mètres carrés, illustre le décalage entre l’image du « prince de Saint-Germain » et une réalité beaucoup plus modeste. La propriétaire actuelle, Nicole Bertolt, gardienne de ce lieu-mémoire, rappelle son caractère unique.

L’escalier de chêne usé menant à cet espace exigu témoigne d’une vie quotidienne loin des paillettes. Les murs conservent les traces d’une bohème authentique, celle qui précède la glorification posthume. Ce choix d’installation à Pigalle, loin de Saint-Germain, marque déjà une prise de distance géographique avec le quartier désormais associé à son nom.
Le voisin c’est Jacques Prévert, le propriétaire c’est le Moulin Rouge
– Nicole Bertolt, Le Vif Weekend
Au-delà de la Cité Véron, d’autres adresses jalonnent le parcours parisien de Vian. Le 10 rue de Verneuil, dans le 7ᵉ arrondissement, demeure méconnu des itinéraires classiques. L’Office du Jazz, rue de Bourgogne, représente une dimension professionnelle totalement absente des guides touristiques : Vian y travaillait comme ingénieur du son, révélant une facette technique de son rapport à la musique.
| Période | Adresse | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 1953-1959 | 6 bis Cité Véron (18e) | Appartement derrière le Moulin Rouge |
| Années 1940-50 | Café de Flore | 172 Boulevard Saint-Germain |
| Années 1940-50 | Les Deux Magots | 6 Place Saint-Germain des Prés |
Ces vestiges architecturaux imposent une lecture spatiale nuancée. Vian n’a jamais vécu au cœur de Saint-Germain, mais y gravitait professionnellement et socialement. La distinction entre lieux de vie et lieux de représentation devient essentielle pour comprendre son rapport ambivalent au quartier.
La chronologie méconnue : trois Boris Vian à Saint-Germain
Parcourir Saint-Germain sur les traces de Vian nécessite d’abord de choisir quel Vian on cherche. Les itinéraires classiques mélangent anachroniquement des périodes et des identités qui correspondent à des vies presque séparées. Une approche chronologique stratifiée révèle trois temporalités distinctes, trois personnages successifs qui ont occupé différemment le même territoire.
La première période, 1940-1946, correspond au Vian ingénieur-jazzman, figure encore marginale de la scène musicale clandestine. Avant la célébrité littéraire, il fréquente les caves comme musicien amateur passionné, dans un Saint-Germain encore populaire. Selon RetroNews, l’âge d’or des caves de Saint-Germain ne dura que de 1946 à 1948, cristallisant une période extrêmement brève mais mythifiée.
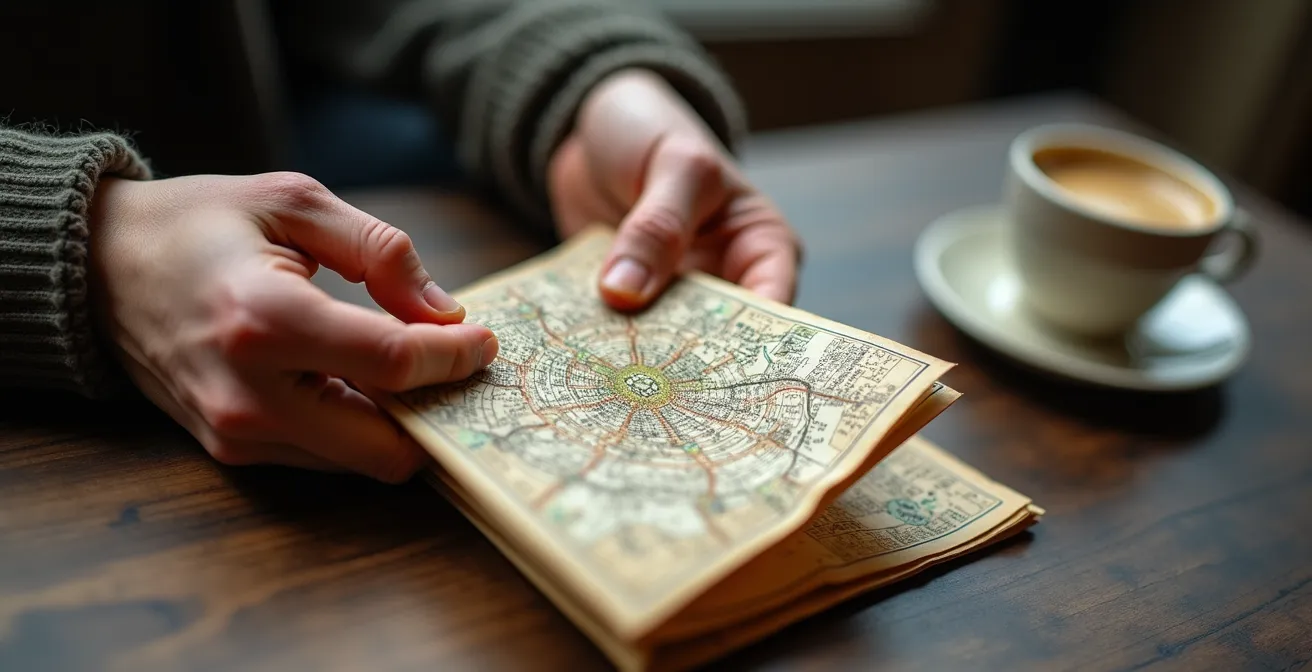
Reconstituer ces strates temporelles exige une cartographie mentale complexe, comme celle que pourrait dessiner un visiteur attentif annotant un plan ancien. Chaque rue, chaque café correspond à une époque différente de la présence vianienne, nécessitant de distinguer les couches successives d’occupation du territoire.
Les trois périodes de Boris Vian à Saint-Germain
- 1940-1945 : Période Zazou – Découverte du jazz au Hot Club de France
- 1945-1950 : Prince de Saint-Germain – Épicentre du microcosme culturel
- 1950-1959 : Période Pataphysique – Membre du Collège depuis 1953
La deuxième période, 1946-1950, voit l’émergence du Vian écrivain-scandale et célébrité. L’Écume des jours puis J’irai cracher sur vos tombes le propulsent au centre de la vie intellectuelle saint-germanoise. Il incarne alors le mythe en construction, participant activement aux nuits enfiévrées du Tabou et du Club Saint-Germain. C’est le Vian des photographies iconiques, trompette en main, entouré de Sartre, Beauvoir et Gréco.
La troisième période, 1950-1959, marque le retrait progressif. Malade, déçu par la commercialisation du quartier, Vian s’en éloigne géographiquement et symboliquement. Son installation Cité Véron en 1953 concrétise cette rupture. Un témoignage révèle que lorsque Vian emménage dans cet appartement minuscule, il traverse une période de dépression intense, marquant sa distance définitive avec le Saint-Germain devenu attraction touristique.
La cartographie sonore : jazz, trompette et paysages auditifs disparus
Explorer Saint-Germain par ce que Vian y entendait offre une dimension radicalement alternative aux parcours visuels classiques. Musicien avant d’être romancier, ingénieur du son de formation, Vian percevait le quartier comme un paysage acoustique complexe. Reconstituer cette géographie auditive permet une immersion sensorielle dans l’univers vianien.
Le réseau souterrain des caves de jazz constituait l’infrastructure sonore du quartier. Entre printemps 1946 et Noël 1948, au moins 6 clubs de jazz ouvrirent leurs portes, transformant Saint-Germain en capitale européenne du jazz moderne. Cette concentration exceptionnelle créait une densité sonore unique, où l’on passait d’une cave à l’autre en suivant les résonances qui s’échappaient des soupiraux.

La trompette de Vian, instrument emblématique de sa double identité, résonnait dans ces espaces confinés dotés d’une acoustique particulière. Le laiton patiné des instruments d’époque, usé par des milliers d’heures de jeu, porte encore la mémoire tactile et sonore de ces nuits. Les caves voûtées amplifiaient naturellement les cuivres tout en étouffant les percussions, créant un son caractéristique du jazz saint-germanois.
| Club | Adresse | Période d’activité |
|---|---|---|
| Le Tabou | 33 rue Dauphine | 1947-1962 |
| Caveau des Lorientais | 5 rue des Carmes | Jusqu’en 1947 |
| Club Saint-Germain | 13 rue Saint-Benoit | Ouvert en juin 1948 |
L’Office du Jazz, rue de Bourgogne, représente un lieu professionnel totalement absent des parcours touristiques. Vian y travaillait comme directeur artistique, enregistrant et promouvant les musiciens américains. Cette fonction d’intermédiaire culturel, de passeur entre le jazz américain et le public français, constitue peut-être son rôle le plus déterminant dans l’histoire musicale du quartier.
Les lieux de silence contrebalançaient nécessairement cette saturation sonore. Bibliothèques, appartements, jardins du Luxembourg offraient les contrepoints indispensables à l’écriture. Vian composait souvent la nuit, après les concerts, dans le calme relatif de ses espaces domestiques. Cette alternance entre immersion sonore et retrait silencieux structurait son rapport au territoire.
Vian contre Saint-Germain : quand l’icône rejette son mythe
L’ironie fondamentale de tout parcours vianien réside dans cette contradiction : Vian a progressivement rejeté le mythe Saint-Germain dont il était devenu malgré lui l’incarnation. Dès 1950, il critique ouvertement la « saint-germanisation », se moquant des touristes culturels venus consommer un existentialisme de pacotille. Cette dimension critique doit nourrir une visite lucide, consciente de ses propres contradictions.
Le périmètre sacré cesse d’être une frontière. On danse dans des celliers sans esprit, aménagés à la diable par des limonadiers
– Philippe Boggio, Biographie de Boris Vian
Cette citation de son biographe Philippe Boggio résume le désenchantement vianien face à la commercialisation rapide du quartier. En quelques années, l’authenticité des premières caves céda la place à une industrie touristique qui vendait une image figée de la bohème. Vian percevait cette transformation comme une trahison des valeurs initiales de spontanéité et d’expérimentation.
La visite de Duke Ellington en juillet 1948
Duke Ellington, accueilli par Boris Vian à la Gare du Nord, se produit au Club Saint-Germain, marquant l’une des soirées les plus mythiques du quartier et illustrant le rôle de Vian comme passeur entre jazz américain et culture française.
Cet événement symbolise le moment d’apogée du Saint-Germain authentique selon Vian : une rencontre directe entre artistes, sans médiation commerciale excessive. Mais déjà, la presse commençait à transformer ces moments d’exception en attractions programmées. La spontanéité cédait progressivement à la spectacularisation.
Son déménagement Cité Véron en 1953 constitue une rupture géographique et symbolique. Quitter la rive gauche pour Pigalle signifiait refuser d’être assigné au rôle de figure tutélaire d’un quartier devenu cliché. Vian recherchait ailleurs l’anonymat et la liberté créative que Saint-Germain ne lui offrait plus. Cette lucidité critique peut transformer notre propre visite : plutôt que de consommer nostalgiquement le mythe, nous pouvons adopter la distance ironique que Vian lui-même pratiquait.
À retenir
- Les adresses réelles de Vian révèlent un décalage entre mythe touristique et vie quotidienne modeste
- Trois périodes chronologiques distinctes correspondent à trois identités successives dans le même espace
- La dimension sonore offre une cartographie alternative centrée sur l’acoustique des caves de jazz
- Vian a critiqué la commercialisation de Saint-Germain, créant une ironie pour tout parcours contemporain
- Composer un itinéraire personnalisé selon ses affinités permet une relation authentique avec son héritage
Composer son propre itinéraire vianien selon ses affinités
Plutôt qu’imposer un parcours unique et prescriptif, une approche personnalisée selon les affinités de chacun respecte mieux la multiplicité des identités vianiennes. Musicien, romancier, ingénieur, critique social : chaque facette suggère un itinéraire différent. Cette méthode de composition autonome transforme la visite en dialogue personnel avec l’héritage vianien.
Le territoire concerné demeure remarquablement compact. Le territoire de Saint-Germain-des-Prés ne couvre qu’1 km², permettant des déambulations entièrement piétonnes. Cette concentration spatiale facilite les allers-retours, les recoupements chronologiques, les superpositions de strates mémorielles. On peut arpenter en quelques heures un espace qui condense plusieurs décennies d’histoire culturelle.
| Parcours | Durée estimée | Nombre de lieux |
|---|---|---|
| Circuit jazz et caves | 2h00 | 5-6 lieux |
| Parcours littéraire | 3h00 | 7-8 lieux |
| Visite Cité Véron | 1h30 | 1 lieu principal |
Le parcours musical privilégie les caves de jazz disparues ou transformées, l’Office du Jazz, les lieux d’enregistrement. Il nécessite une capacité d’imagination historique importante, car la plupart de ces espaces ont physiquement disparu. La visite devient alors une reconstitution mentale guidée par les adresses, les descriptions d’époque, les photographies d’archives. Ceux qui s’intéressent aux itinéraires culturels secrets découvriront dans cette approche une méthodologie applicable à d’autres territoires mémoriels.
Le parcours littéraire se concentre sur les cafés, librairies et appartements associés à l’écriture. Flore, Deux Magots, mais aussi les adresses plus confidentielles rue de Verneuil ou Cité Véron. Ce circuit permet de matérialiser les lieux d’écriture de L’Écume des jours, L’Automne à Pékin ou des chroniques de jazz. Les plaques commémoratives, relativement discrètes à Paris, exigent une attention soutenue.
La visite de l’appartement Cité Véron constitue l’expérience la plus immersive mais aussi la plus difficile d’accès. Elle nécessite une démarche anticipée et respectueuse du caractère privé des lieux.
Guide pratique pour visiter l’appartement Cité Véron
- Étape 1 : Envoyer une lettre manuscrite motivée à Nicole Bertolt – 6 bis Cité Véron 75018 Paris
- Étape 2 : Attendre la proposition de date selon disponibilités
- Étape 3 : Se présenter au 6 bis Cité Véron (métro Blanche) à l’heure convenue
- Étape 4 : Respecter l’interdiction de photos et films dans ce lieu privé
Le parcours critique, enfin, suit les lieux de désenchantement et de prise de distance. Il commence à Saint-Germain pour finir Cité Véron, reproduisant le mouvement géographique et symbolique de Vian lui-même. Ce circuit interroge la muséification des lieux de mémoire, la transformation de l’authenticité en folklore touristique. Il invite à une réflexivité sur notre propre démarche de visiteur. Pour ceux qui souhaitent approfondir cette réflexion et planifiez votre itinéraire culturel avec lucidité, cette approche critique constitue un préalable méthodologique essentiel.
Questions fréquentes sur Boris Vian à Paris
Vian a-t-il créé le mythe de Saint-Germain-des-Prés ?
Non, contrairement à la légende, Vian n’a pas créé Saint-Germain-des-Prés mais en fut une figure emblématique. Le quartier existait comme pôle intellectuel avant son arrivée, porté par Sartre, Beauvoir et d’autres. Vian a participé à l’âge d’or des caves de jazz entre 1946 et 1950, puis s’est progressivement distancié du mythe qu’il trouvait commercialisé et vidé de son authenticité initiale.
Peut-on encore visiter les lieux fréquentés par Boris Vian ?
Oui et non. Les cafés emblématiques comme le Flore et les Deux Magots existent toujours, mais transformés en attractions touristiques. La plupart des caves de jazz ont disparu ou changé de fonction. L’appartement de la Cité Véron se visite sur rendez-vous uniquement, après demande écrite auprès de la propriétaire actuelle. Les lieux professionnels comme l’Office du Jazz ne sont plus accessibles.
Quelle est la meilleure période pour un parcours vianien à Paris ?
Le printemps et l’automne offrent les meilleures conditions pour déambuler dans Saint-Germain. Les soirées de septembre évoquent l’atmosphère des rentrées littéraires que Vian connaissait. L’hiver permet d’imaginer l’ambiance des caves enfumées où l’on se réfugiait. Évitez l’été où l’affluence touristique rend difficile l’immersion contemplative nécessaire à ce type de visite mémorielle.
Combien de temps faut-il prévoir pour un parcours complet ?
Un parcours complet nécessite une journée entière, soit environ six à sept heures de marche et de visites. Le circuit jazz demande deux heures, le parcours littéraire trois heures, et la visite de la Cité Véron une heure trente. Il est recommandé de fragmenter la découverte en plusieurs visites thématiques plutôt que de tout concentrer en une seule journée marathon.